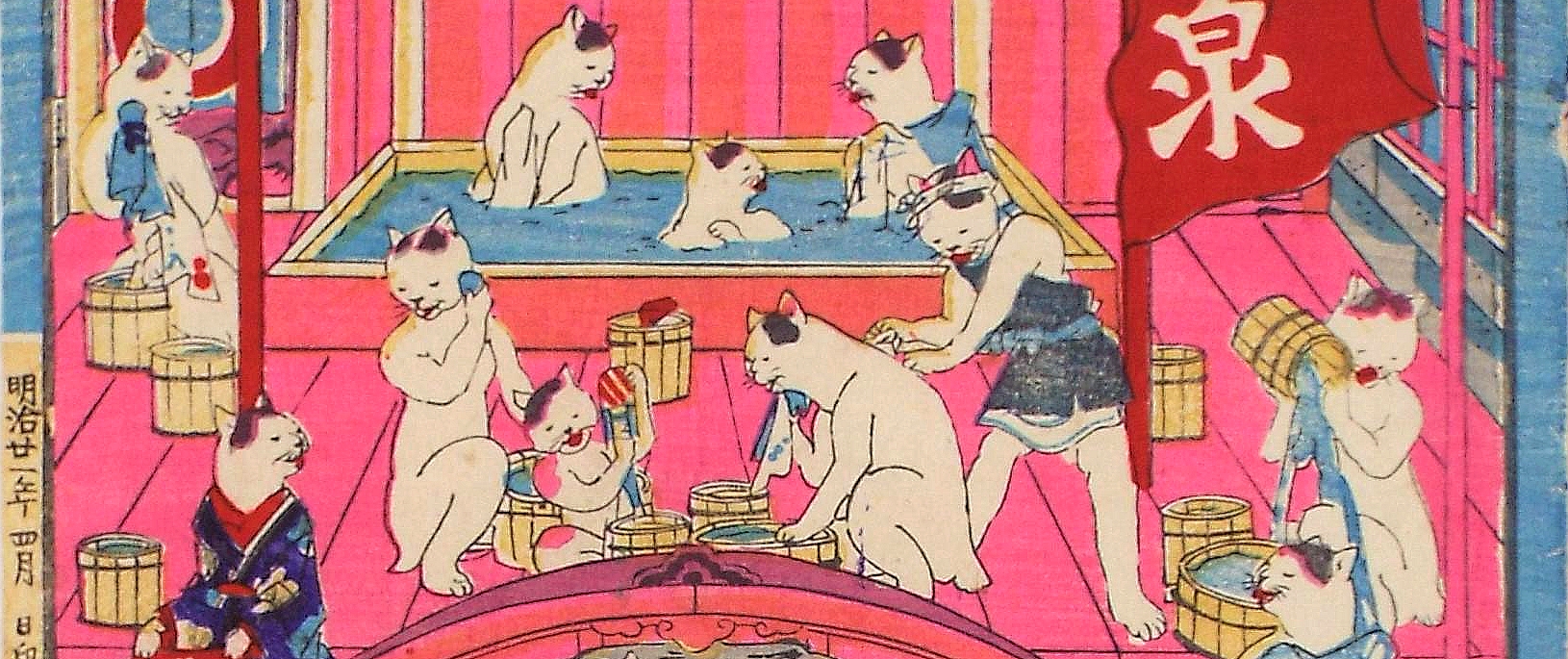Durant cette année 2018, vous entendrez ou vous lirez souvent que l’on parle des 160 ans des relations « diplomatiques » entre la France et le Japon. Ou que le Traité signé en 1858 entre ces deux pays a, pour la première fois de leur histoire respective, ouvert la voie à des relations bilatérales.
Si l’on considère le terme « diplomatie » dans un sens strict et quelque peu étroit qui accorde cette activité exclusivement à un État ou au nom d’un État, alors, oui, les relations diplomatiques ont officiellement commencé à la signature de ce Traité. Mais si, comme de nombreux dictionnaires le font, on entend ce mot dans un sens plus large et que l’on considère aussi qu’une ambassade ou une mission ont aussi un caractère diplomatique, alors on peut dire que les relations diplomatiques entre la France et le Japon ont débuté bien plus tôt. Surtout si l’on tient compte du fait que le Japon ne s’est vraiment constitué en tant qu’état-nation unifié et indivisible qu’à partir de l’ère Meiji, et que jusque-là, les domaines ou han pouvaient être assimilés, dans les faits, à des états quasi indépendants ayant à leur tête un daimyō qui faisait figure d’autorité suprême sur ces sujets, et qui régnait  sur un domaine aux frontières infranchissables sauf autorisation ou dérogation spéciale (on pourrait parler de visa), alors on peut considérer que la mission HASEKURA, voulue par le seigneur DATE Masamune mais sans l’approbation du pouvoir central, qui permit à des Japonais de fouler la terre de France en 1615 à Saint-Tropez (photo de droite), comme la mission de François Caron qui, quatre ans plus tard, en 1619, fut le premier Français à officiellement débarquer au Japon, porteur d’une lettre de Louis XIV sollicitant une relation avec ce pays – laquelle fut toutefois repoussée par le shōgun de l’époque, constituent les deux vraies premières relations diplomatiques entre ces deux pays.
sur un domaine aux frontières infranchissables sauf autorisation ou dérogation spéciale (on pourrait parler de visa), alors on peut considérer que la mission HASEKURA, voulue par le seigneur DATE Masamune mais sans l’approbation du pouvoir central, qui permit à des Japonais de fouler la terre de France en 1615 à Saint-Tropez (photo de droite), comme la mission de François Caron qui, quatre ans plus tard, en 1619, fut le premier Français à officiellement débarquer au Japon, porteur d’une lettre de Louis XIV sollicitant une relation avec ce pays – laquelle fut toutefois repoussée par le shōgun de l’époque, constituent les deux vraies premières relations diplomatiques entre ces deux pays.
De plus, d’autres tentatives eurent lieu pendant cette période appelée sakoku durant laquelle le Japon décida de fermer ses ports aux bateaux étrangers et fut quasi-totalement isolé du reste du monde, comme par exemple le périple de LA PEROUSE qui conduisit ce dernier vers la pointe nord de l’actuel Hokkaîdō, dont le détroit qui le sépare de l’île de Sakhaline porte son nom mais aussi, et surtout, les tentatives françaises, à chaque fois avortées, de nouer une relation avec le Japon via le gouvernement d’Okinawa, situé dans ces îles Ryūkyū et qui était placé sous l’autorité du clan SHIMAZU, seigneur de Satsuma. Donc du Japon.
Nous avons cité le mot sakoku ci-dessus, en expliquant qu’il signifiait « fermeture du pays ». Et voilà qui nous conduit directement à réfléchir sur cette « querelle » évoquée en titre de cet article. En effet, de nos jours, si certains parlent d’un isolement total ou quasi-total du Japon pendant près de 250 ans, d’autres nient le fait même que le Japon ait été fermé à l’Occident et prétendent que ce terme de sakoku est totalement abusif. Quand je dis « certains », cela désigne aussi bien des Français que des Japonais.
La réponse que nous proposons ici, bercé par la douce illusion que nous contribuerons peut-être à apaiser un peu cette querelle, est celle de la voie du milieu. Qui se défend de se situer dans un extrême comme dans un autre. Car en effet, comme nous allons le montrer, dire que le Japon a été totalement ou même quasi-totalement isolé de l’étranger est faux, et prétendre à l’inverse qu’il ne le fut pas du tout est également une erreur.
Première remarque : le mot de sakoku, s’il a été employé pour la première fois avant, s’est surtout largement généralisé pendant l’ère Meiji. Ce qui suffit à nous inciter à la prudence. En effet, cette période fut particulièrement propice à, sinon une révision totale de l’histoire passé, au moins une interprétation ou une présentation qui devait, entre autres objectifs, satisfaire les intérêts de ses dirigeants. C’est ainsi que, par moments, l’histoire du Japon n’est pas exactement ce qu’elle fut vraiment. Et, en l’occurrence, on peut facilement imaginer que, pour justifier la nouvelle ouverture du Japon à l’Occident et sa marche forcée vers l’industrialisation et la modernité, les gouvernants de l’époque avaient tout intérêt à montrer combien la faiblesse de leur pays au moment de l’arrivée du commodore PERRY était due à la politique isolationniste du bakufu d’Edo – ou autrement dit des gouvernements successifs des shōgun de la dynastie des TOKUGAWA. Nécessairement, cela devait être les erreurs commises par leurs prédécesseurs et le régime politique mis en place par eux qui étaient la cause de la terrible menace d’une possible colonisation exercée par ces « barbares du sud » et la salut du Japon, et donc son indépendance, ne pouvait passer que par une profonde transformation des institutions elles-mêmes, aussi douloureuses que pourraient être les décisions prises pour faire du Japon une nation unie et forte, capable de traiter d’égal à égal avec les grandes nations d’Europe ainsi que les États-Unis, sans oublier la Russie et la Chine.
Or, en réalité, cette politique isolationniste ne fut pas aussi contraignante qu’on veut bien le croire – ou qu’on veut nous le faire croire. C’est vrai, elle le fut essentiellement pour la grande majorité de la population. Par exemple, dès le début et le milieu du 17ème siècle, si les étrangers étaient refoulés ou parfois poursuivis et tués, les Japonais eux-mêmes encouraient la peine de mort s’ils essayaient de quitter le pays. Ainsi, pour les en dissuader, la taille des navire fut limitée, seule la construction de relativement petites embarcations destinée uniquement à la pêche côtière ou le cabotage étant autorisée. Mais ce fut beaucoup moins le cas pour une élite, celle qui entourait le shōgun d’abord, puis élargie à quelques privilégiés de ce qu’on appellerait de nos jours la société civile. Notamment les « scientifiques » de l’époque, mais aussi les artistes.
Il faut en effet comprendre que la grande cause de cette politique isolationniste fut le prosélytisme chrétien, et plus précisément catholique. C’est la crainte, puis la peur des missionnaires et surtout le rythme relativement rapide et du nombre élevé de la conversion de Japonais au christianisme qui motivèrent les premiers shōgun à d’abord les combattre, puis les pourchasser et pour certains d’entre eux les massacrer. Jusqu’à donc leur interdire totalement l’accès au pays.
Le début de l’époque dite du sakoku est souvent considéré comme ayant été décidé en 1641. Or la fermeture du pays fut progressive. Dès 1616, les ports de Nagasaki et de Hirado sont fermés aux navires étrangers. En 1623 et 1624, c’est le commerce avec l’Angleterre et l’Espagne qui est arrêté. Et les décrets dits du sakoku, au nombre de 5, s’étalent entre 1633 et 1639. Et si les Hollandais furent – ou sont considérés comme – les seuls étrangers à pouvoir continuer à commercer avec le Japon dans l’île de Dejima à Nagasaki (ils déménagèrent de la ville de Hirado à l’île de Dejima en 1641), ils le doivent essentiellement au fait qu’ils étaient protestants et qu’ils s’engagèrent à ne faire aucune propagande religieuse (photo de Dejima en couverture).
Par ailleurs, en raison de l’intérêt ou de la curiosité de certains shōgun, en particulier le 8ème shōgun TOKUGAWA Yoshimune, pour l’Europe et ses sciences ou sa production, ce qui n’avait pas d’aspect religieux bénéficia d’une certaine tolérance.
A ce titre, on peut citer les livres : s’ils commencèrent par être interdits au début du sakoku, les livres occidentaux profitèrent dès 1720 d’une levée partielle de l’interdiction qui les frappait grâce à Yoshimune. On estime que c’est ainsi qu’un livre en particulier entra au Japon : il s’agit du traité intitulé « Perspectiva pictorum et architectorum in qua docetur modus expeditissimus delineandi optice quae pertinent ad architecturam » écrit par le peintre, architecte, créateur de décor et par ailleurs frère laïque jésuite Andrea POZZO entre 1693 et 1698. On pense que sa traduction en chinois par des jésuites portugais fut connue au Japon dès 1738.  Et c’est ainsi que cet éminent spécialiste italien des perspectives en architecture et en peinture aurait commencé à influencer, entre autres, les peintres de ukiyoe. Dont notamment OKUMURA Masanobu qui, encore assez maladroitement, introduisit une perspective linéaire dans ses estampes, comme par exemple cette représentation d’une salle de spectacle datant de 1743 (photo de droite). Masanobu est d’ailleurs considéré comme celui qui « révolutionna » l’estampe, en réalisant des formats nouveaux (très verticaux), des points de vue innovants et des techniques importées ou influencées par la peinture occidentale, comme donc la perspective
Et c’est ainsi que cet éminent spécialiste italien des perspectives en architecture et en peinture aurait commencé à influencer, entre autres, les peintres de ukiyoe. Dont notamment OKUMURA Masanobu qui, encore assez maladroitement, introduisit une perspective linéaire dans ses estampes, comme par exemple cette représentation d’une salle de spectacle datant de 1743 (photo de droite). Masanobu est d’ailleurs considéré comme celui qui « révolutionna » l’estampe, en réalisant des formats nouveaux (très verticaux), des points de vue innovants et des techniques importées ou influencées par la peinture occidentale, comme donc la perspective  linéaire.
linéaire.
On trouve un autre exemple d’importation d’importance durant l’époque du sakoku d’un ouvrage scientifique européen : elle est attestée par ce qui est considéré comme la toute première traduction en japonais, via le hollandais, du traité d’anatomie « Anatomische Tabellen » de l’allemand Johann Adam KULMUS qui a donné ouvrage intitulé « Kaitai shinsho ». La photo de gauche représente une copie de ce livre dont la première édition est datée 1774.
Autre considération très importante : on a, détestable habitude, de toujours globaliser un pays en disant « le Japon » ou « la France » et en parlant de sa population en disant « les Français » ou « les Japonais », sans aucune nuance. Or, il faut bien prendre en compte que le Japon de l’époque d’Edo, s’il avait été unifié par ceux qu’on appelle justement « les trois grands unificateurs » que furent successivement ODA Nobunaga puis TOYOTOMI Hideyoshi et enfin TOKUGAWA Ieyasu, était en fait un pays où régnait une véritable « fracture » entre l’est et l’ouest du pays. Une fracture née à l’époque Sengoku et consolidée avec la bataille de Sekigahara, en 1600, qui vit la victoire des armées de l’est, dirigée par Ieyasu, sur les armées de l’ouest commandée par le chef du clan Mōri, seigneur du domaine de Chōshū.
Cette fracture fit que les grands responsables des territoires de l’ouest du Japon furent quasi totalement exclus de tous les gouvernements shogunaux de l’époque d’Edo.
Or, ces territoires de l’ouest étaient ceux qui, géographiquement, étaient situés le plus près du continent comme le rappelle cette carte de droite. C’est pourquoi Nagasaki et l’île artificielle de Dejima furent choisies pour être la seule porte d’entrée des étrangers : ceux-ci arrivant du Sud de l’Asie, ces territoires avaient la plus grande habitude des relations internationales. Et quand on parle des Hollandais comme seuls occidentaux autorisés à commercer durant le sakoku, c’est souvent pour mieux oublier que Nagasaki resta également ouvert au commerce avec les Chinois et, dans une moindre mesure, avec les Coréens.
D’autre part, le domaine situé à l’extrême ouest – on dit souvent au sud en France – le domaine de Satsuma, était celui dans lequel on trouvait le plus de commerce parallèle : la contrebande. Laquelle favorisa l’entrée illégale mais nombreuse d’objets en provenance de l’étranger. Et si l’on ajoute à cela que bien des européens commerçaient avec la Chine et qu’une partie des biens occidentaux, arrivés du coté de Macao ou Hong-Kong, étaient ensuite emportés au Japon par des Chinois, on comprend alors que l’isolement du Japon fut assez… relatif.
Les exemples de « failles » dans la politique dite d’isolement sont relativement nombreux, nous ne les citerons évidemment pas ici. Mais ils permettent de mieux comprendre ce que fut réellement le sakoku et d’en tirer plusieurs conclusions.
La première est que ceux qui, actuellement, au Japon comme en France, prétendent que le sakoku n’a pas existé, sont dans l’erreur : l’ouverture du Japon à l’occident fut malgré tout très limitée et ne bénéficia qu’à quelques élites seulement. La très grande majorité de la population, si on sait qu’elle était relativement bien éduquée et qu’elle savait souvent lire, écrire et compter, n’eût en revanche aucun accès direct à la connaissance européenne ni de contacts physiques avec les étrangers. En ce sens, parler d’isolement du Japon est relativement exact.
Deuxième conclusion : inversement, ce terme d’isolement, dès lors qu’il suggère une fermeture totale ou quasi totale du pays, est également abusif et constitue une erreur de traduction du terme sakoku ou du moins de son esprit : il apparaît sans doute bien plus exact de parler de « politique de relations avec l’étranger hyper contrôlée ». Or hyper contrôlée ne signifie pas inexistante.
Troisième conclusion, on comprend mieux deux points très importants. Le premier explique l’une des causes essentielles de la chute de la maison TOKUGAWA à la fin de cette longue période d’Edo, durant cette période d’une quinzaine d’année qu’on appelle donc le bakumatsu. Bien des gens, à travers le monde, attribuent cette chute ou la résument à l’arrivée au Japon, dans les années 1850, des occidentaux dont le premier fut donc le fameux commodore PERRY en 1853, et la signature des traités de 1854 puis 1858. En réalité, l’arrivée de PERRY fut moins la cause de la fin du système shogunal que l’opportunité que cette arrivée offrit aux fiefs de l’ouest de prendre leur revanche de leur défaite de Sekigahara en 1600, suivie de leur mise à l’écart des gouvernements shogunaux successifs, malgré leur importance en terme de surface géographique et donc de richesse économique. Ce qui initia la chute des shōgun est bien l’arrivée de PERRY, mais ce qui la fit concrètement est surtout une affaire de politique intérieure.
Et, deuxième point très important qui concerne cette fois directement le début de l’ère Meiji : on comprend pourquoi le « nouveau gouvernement » qui prit les rênes du pays au nom de l’Empereur fut essentiellement composé de personnalités originaires des domaines de Satsuma, de Chōshū et de Tosa, et l’on comprend aussi pourquoi le Japon réussit si rapidement, en quelques années à peine, sa modernisation et son occidentalisation sans qu’il n’y perde son âme : en réalité, tout n’est pas parti de zéro, tout ne s’est pas fait en partant d’un système féodal archaïque et complètement ignorant des progrès occidentaux. L’élite japonaise, qui réussit ce qu’on appelle parfois « la Révolution de Meiji », put la réaliser parce que des bases d’une occidentalisation existaient déjà au Japon, bien plus et depuis bien plus longtemps que beaucoup ne le pensent, des bases lentement mais sûrement développées durant toute cette période appelée sakoku.
Enfin, cela permet aussi de comprendre, au sujet du Japonisme, mouvement culturel auquel nous consacrons un large dossier, que si la culture japonaise, et notamment ses arts, provoqua tant d’intérêt et même d’admiration de la part des artistes français et européens dont beaucoup résidaient en France, c’est aussi, comme le pensent certains, dont INAGA Shigemi, chercheur en Beaux-Arts et spécialiste de l’Art comparé qui l’explique dans « La réinterprétation de la perspective linéaire au Japon (1740-1830) et son retour en France (1860-1910) », parce que cette culture qu’ils découvraient était certes totalement japonaise et nouvelle, mais en réalité elle-même empreinte et influencée par nombre de techniques et d’une façon de considérer les arts éminemment européennes, et entrées depuis plus de deux siècles dans ce Japon supposé « isolé »…
(C.Y.)