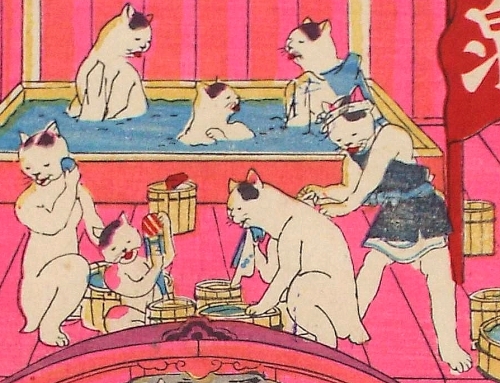(Remarque préliminaire: malgré son titre et de nombreuses références à la France et aux relations franco-japonaises, le sujet principal de cet article concerne bien le Japon et l’évolution de la mentalité de ses gouvernants successifs vis-à-vis des puissances étrangères en général dans les derniers moments du bakumatsu et au début de l’année de la transition vers l’ère Meiji. C’est pour cette raison qu’il se trouve dans cette section dédiée à la présentation générale de l’ère Meiji et non dans celle consacrée spécifiquement aux relations franco-japonaises.)
On l’appelle en français « l’incident de Kōbe ». Et il est vrai qu’il serait normalement difficile de qualifier autrement que par le terme d’« incident » les faits qui se sont produits ce 4 février 1868 dans l’après-midi. Une petite troupe de samouraïs marche, colonne par deux, dans la ville de Kōbe. Il s’agit de gardes du domaine de Bizen à qui le gouvernement japonais a ordonné d’assurer la sécurité de la ville. Au moment où ce groupe arrive à la hauteur du sanctuaire Sannomiya (un petit sanctuaire qui existe toujours au cœur de Kōbe – photo de droite), deux marins français qui sortaient d’un bâtiment voisin tentent de passer de l’autre coté de la rue en coupant cette colonne en son milieu. Les gardes repoussent durement les deux marins qui résistent. C’est alors que l’un des responsables de ces gardes, un dénommé TAKI Zenzaburō, utilise sa lance et blesse l’un des deux marins. Attaqués par une arme blanche, ceux-ci sortent alors leur pistolet. En les voyant, quelques gardes japonais décident immédiatement d’utiliser leurs fusils. Des balles volent, sans toutefois atteindre qui que ce soit. Le cessez-le-feu est rapidement ordonné, le calme revient. Bref, un « incident » finalement assez banal qui aurait pu en rester là. Mais lequel, contre toute attente, va évoluer en une affaire d’État et même en une affaire internationale.
domaine de Bizen à qui le gouvernement japonais a ordonné d’assurer la sécurité de la ville. Au moment où ce groupe arrive à la hauteur du sanctuaire Sannomiya (un petit sanctuaire qui existe toujours au cœur de Kōbe – photo de droite), deux marins français qui sortaient d’un bâtiment voisin tentent de passer de l’autre coté de la rue en coupant cette colonne en son milieu. Les gardes repoussent durement les deux marins qui résistent. C’est alors que l’un des responsables de ces gardes, un dénommé TAKI Zenzaburō, utilise sa lance et blesse l’un des deux marins. Attaqués par une arme blanche, ceux-ci sortent alors leur pistolet. En les voyant, quelques gardes japonais décident immédiatement d’utiliser leurs fusils. Des balles volent, sans toutefois atteindre qui que ce soit. Le cessez-le-feu est rapidement ordonné, le calme revient. Bref, un « incident » finalement assez banal qui aurait pu en rester là. Mais lequel, contre toute attente, va évoluer en une affaire d’État et même en une affaire internationale.
En effet, les commandants des troupes américaines, françaises et anglaises présentes à Kōbe à ce moment-là sont furieux et décident d’envoyer immédiatement une expédition punitive, des dizaines de marins sont dépêchés dans le centre-ville et réussissent à en prendre le contrôle après un certain nombre d’échanges de tirs nourris avec les soldats japonais. Des affrontements qui débordent même les limites des concessions étrangères. La raison invoquée est la protection des civils étrangers présents en nombre à Kōbe, dont le port vient officiellement d’ouvrir le 1er janvier 1868 (photo-titre, vue du port le jour de son inauguration), à peine un mois auparavant donc, et dont la sécurité est manifestement incertaine. Quant aux navires étrangers présents dans la rade, ils retiennent aussi sous contrôle les bateaux japonais. Ces affrontements ne feront toutefois pas de morts, justes quelques blessés supplémentaires.
Mais l’affaire n’en reste pas là. La coalition militaire étrangère présente à Kōbe est placée sous l’autorité politique du  consul britannique Harry Smith PARKES (photo de gauche),
consul britannique Harry Smith PARKES (photo de gauche), lequel, soutenu par le consul français de l’époque Léon ROCHES (photo de droite), va se plaindre durement au gouvernement en l’accusant d’être à l’origine de toute cette affaire : si cet incident a pu se produire, c’est parce que l’existence même de ce gouvernement n’a pas été officiellement transmise aux pays étrangers. Ceux-ci ne savent donc pas s’il est légitime, ni si les soldats qui agissent en son nom le sont aussi. Ils demandent que tous ceux qui ont été mêlés à cet incident soient sévèrement jugés et même que TAKI soit condamné à mort. Le gouvernement japonais est abasourdi, jugeant la sanction bien trop lourde. En effet, au-delà des dépositions des Japonais, même des étrangers présents au moment des faits ont témoigné que les tirs des gardes japonais ne visaient sans doute pas les marins français ni les autres étrangers rapidement accourus mais ne constituaient que des tirs d’avertissement, donc sans intention de tuer. Mais PARKES reste inflexible, cet incident n’est pour lui que secondaire, il s’en est saisi que comme prétexte pour accuser le gouvernement japonais de ne pas vraiment respecter les forces internationales puisqu’il ne les a même pas informé de sa constitution quelques mois auparavant alors que des traités de paix et d’amitiés sont signés depuis déjà 10 ans. Ce qui, du reste, est parfaitement exact. Et PARKES menace le gouvernement : si les réparations réclamées ne sont pas accordées, ce n’est plus un homme, en l’occurrence TAKI, le responsable des gardes, ce n’est même pas le domaine de Bizen d’où viennent ces gardes, c’est le Japon dans son ensemble qui sera considéré comme pays ennemi. Et qu’il sera alors traité en tant que tel… Ce sont là de véritables menaces, à peine voilées.
lequel, soutenu par le consul français de l’époque Léon ROCHES (photo de droite), va se plaindre durement au gouvernement en l’accusant d’être à l’origine de toute cette affaire : si cet incident a pu se produire, c’est parce que l’existence même de ce gouvernement n’a pas été officiellement transmise aux pays étrangers. Ceux-ci ne savent donc pas s’il est légitime, ni si les soldats qui agissent en son nom le sont aussi. Ils demandent que tous ceux qui ont été mêlés à cet incident soient sévèrement jugés et même que TAKI soit condamné à mort. Le gouvernement japonais est abasourdi, jugeant la sanction bien trop lourde. En effet, au-delà des dépositions des Japonais, même des étrangers présents au moment des faits ont témoigné que les tirs des gardes japonais ne visaient sans doute pas les marins français ni les autres étrangers rapidement accourus mais ne constituaient que des tirs d’avertissement, donc sans intention de tuer. Mais PARKES reste inflexible, cet incident n’est pour lui que secondaire, il s’en est saisi que comme prétexte pour accuser le gouvernement japonais de ne pas vraiment respecter les forces internationales puisqu’il ne les a même pas informé de sa constitution quelques mois auparavant alors que des traités de paix et d’amitiés sont signés depuis déjà 10 ans. Ce qui, du reste, est parfaitement exact. Et PARKES menace le gouvernement : si les réparations réclamées ne sont pas accordées, ce n’est plus un homme, en l’occurrence TAKI, le responsable des gardes, ce n’est même pas le domaine de Bizen d’où viennent ces gardes, c’est le Japon dans son ensemble qui sera considéré comme pays ennemi. Et qu’il sera alors traité en tant que tel… Ce sont là de véritables menaces, à peine voilées.
Le gouvernement est plongé dans l’embarras. Mais il lui faut agir et éviter le pire. Alertée d’urgence, la Cour Impériale, 4 jours plus tard, informe officiellement les forces étrangères que le pouvoir a été transmis du shōgun démissionnaire au nouveau gouvernement du Japon qui agit en son nom. Et après maintes et maintes hésitations, ce gouvernement décide d’accéder à la demande de PARKES et de ROCHES : le 24 février, soit à peine 20 jours après l’incident initial, il prend la décision d’imposer à TAKI de se faire seppuku.
Officiellement, « l’incident de Kōbe » est ainsi clos.
Cet « incident de Kōbe » n’est souvent présenté que comme l’un des multiples faits divers qui se sont produit durant cette époque entre les Japonais et les étrangers, et même comme relativement anecdotique du fait qu’il n’a engendré que quelques blessés. Mais en réalité, s’il est vrai que des évènements comme celui du bombardement de Shimonoseki, quelques années auparavant, ou l’incident dit de Sakai qui surviendra quelques semaines plus tard, ont fait bien plus de dégâts et de morts, celui de Kōbe est peut-être l’un des épisodes majeurs de la construction du Japon moderne et de ses relations internationales, et en particulier des relations franco-japonaises. Il est peut-être l’élément principal qui fait que le « Traité de paix, d’amitié et de commerce entre la France et le Japon » dont on commémorera, en 2018, le 160ème anniversaire, est réellement entré en vigueur 10 ans plus tard, en 1868. Et pour réaliser son importance, il faut commencer par bien comprendre les conditions dans lesquelles il s’est produit.
Coté international, cela fait donc 10 ans que des traités ont été signés avec le Japon, qui autorisent les étrangers à commercer avec ce pays. Or ce commerce international n’existe que grâce à la marine, les navires et les ports – et pour cause : le Japon est une île. Mais les ports japonais ne s’ouvrent que très progressivement. Et si des ports comme Nagasaki, déjà ouvert aux Hollandais durant toute la période d’Edo, Yokohama ou autre Hakodate se sont rapidement ouverts aux étrangers, en revanche, les ports d’Ōsaka et de Kōbe n’ont pas été autorisés, ou quand ils l’ont été plus tard, comme Kōbe, le gouvernement shogunal a toujours observé la plus mauvaise grâce pour rendre cette ouverture effective. Et ce pour une raison principale : la trop grande proximité de la capitale, Kyōto, où réside l’empereur. Car si les Japonais ont dû se résoudre à bien des concessions depuis l’arrivée en 1853 du commodore M. PERRY, la signature de la Convention de Kanagawa en 1854 puis celle des traités internationaux en 1858, ils ont toujours essayé de faire en sorte que cette ouverture forcée par les étrangers se réalise mais loin de Kyōto. Au fond d’eux, ils n’ont jamais cessé de craindre une réelle colonisation de leur pays et une perte de son indépendance si jamais l’Empire était renversé. L’exemple de la Chine voisine dont certaines villes ont été totalement colonisées et une partie de leur population traitée comme des esclaves est bien trop présent dans leur esprit. Or, de leur coté, les puissances étrangères ont très rapidement compris que la région du Kansai actuel, avec notamment les villes d’Ōsaka et de Kyōto, la capitale, était sans doute la première région en terme de potentiel commercial et elles guettaient toutes les occasions qui se présenteraient pour accéder à ce marché plein de promesses de fortune. En un mot, les étrangers s’impatientaient.
Coté franco-japonais plus spécifiquement, il faut prendre en compte une dimension politique et diplomatique qui explique le comportement des Français et en particulier celui de son premier représentant, Léon ROCHES, en ce début d’année 1868. La France de cette époque est plongée dans le doute : faut-il continuer de soutenir le shōgun comme elle l’a toujours fait jusque là ou vaut-il mieux dorénavant s’allier à la Cour impériale ? Certes, elle connait l’existence de l’Empereur et son autorité suprême, quasi divine. Mais elle sait aussi que le véritable pouvoir est détenu par le shōgun. D’ailleurs, anecdote qui n’est pas totalement innocente, si la traduction française du Traité de 1858 qui a été signée témoigne qu’il engage « S. M. l’Empereur des Français » et « S. M. L’Empereur du Japon », la version originale en japonais cite, comme autorité suprême japonaise, le Taikun, titre honorifique donné au shōgun…
Certes, la France a été informée que, l’année précédente, en 1867, celui qui est devenu le dernier des shōgun, TOKUGAWA Yoshinobu, a rendu à l’Empereur l’ensemble de ses pouvoirs militaires, politiques et économiques. Elle sait aussi qu’un nouveau gouvernement a été formé par cet empereur. Mais si ceci est bien la réalité, celle-ci n’en demeure pas moins qu’assez théorique dans l’esprit des Français. D’abord, l’Empereur lui-même est très jeune : il est né en 1852 et au moment de son accession en 1867, au décès de son père, il n’a que 15 ans. Il n’est donc encore qu’un adolescent: peut-on lui faire vraiment confiance ?
D’autre part, le gouvernement qu’il a formé est constitué des principaux opposants au shōgun qui l’ont progressivement poussé à l’abdication et ont, en quelque sorte, pris sa place. Ce qui fait qu’un certain nombre de seigneurs de domaines (han) ne le considèrent pas vraiment comme légitime, ils le voient surtout comme une autorité auto-proclamée suprême qui en a juste remplacé l’ancienne autorité et se comporte de façon tout autant dictatoriale. Enfin, la contestation interne bat son plein au Japon, et quoique démissionnaire, le shōgun a engagé avec ses derniers soutiens une série de batailles contre ses opposants dont les principaux sont les domaines de Tosa, de Chōshū et de Satsuma, à la tête duquel se trouve un très grand général : SAIGŌ Takamori. La première de ces batailles est celle de Toba-Fushimi, elle a commencé le 27 janvier 1868 et elle annonce une période de plusieurs batailles, de 1868 à 1869, connue sous le nom générique de « Guerre de Boshin ».
Pourquoi le shōgun, alors qu’il a officiellement remis ses pouvoirs et juré allégeance à l’Empereur, s’en prend-il ainsi aux troupes de cette coalition de domaines réputés eux aussi pro-empereur ? Plusieurs explications existent, comme par exemple la simple vengeance personnelle. Mais la plus plausible est la suivante: s’il a perdu la suprématie de l’autorité nationale, le shōgun et surtout son administration n’en restent pas moins encore les véritables dirigeants du pays. Il y a en effet une grande différence entre la théorie, celle qui consiste à décider de choses comme rendre son pouvoir ou créer un gouvernement, et la réalité pratique, à savoir diriger concrètement un pays. Et Yoshinobu sait – ou imagine – qu’il reste un personnage sans doute incontournable pour garantir l’avenir du Japon : il est l’héritier d’une longue dynastie de shōgun, celle des TOKUGAWA, qui ont régné en maîtres absolus depuis 1603, et il est aussi l’héritier d’un système politique et administratif , celui des gouvernements shogunaux ou bakufu, qui dure depuis près de 700 ans. Face à lui, ses opposants ont peut-être gagné et l’ont conduit à abdiquer, ils n’en restent pas moins tout à fait novices dans le fait de diriger le pays. Il faut comprendre que, durant les dernières années qui se sont écoulées, les opposants ont surtout pensé à combattre le shōgun mais n’ont absolument pas prévu comment et par quoi le remplacer. D’où la volonté de celui-ci d’apparaître aux yeux du jeune empereur comme démissionnaire, certes, de l’ancien gouvernement, mais aussi comme un acteur puissant et par conséquent inévitable du nouveau gouvernement. Et donc son désir de résister à ses vainqueurs, surtout qu’il compte encore le soutien de quelques alliés: il a celui de domaines qui espèrent son retour, il a celui de grands soldats, comme par exemple ENOMOTO Takeaki, le commandant de la marine shogunale et fidèle d’entre les fidèles. Et il a celui des pays étrangers car c’est avec lui que ces pays ont signé les traités et qu’ils ont appris à lui faire confiance. En particulier la France, qui a accepté de l’aider, notamment en envoyant une mission militaire, arrivée en janvier 1867 et qui, durant un an, va contribuer à la formation des armées shogunales aux techniques modernes.
Une France, donc, qui, au moment de « l’incident de Kōbe », est en pleine hésitation. Qui doit-elle vraiment soutenir entre le shōgun et l’empereur ? Ou plutôt comment se faire un ami de l’un quel qu’il soit sans risquer de faire de l’autre un ennemi, ne connaissant pas à ce moment l’issue de cette Guerre de Boshin qui vient de débuter à peine une semaine avant cet « incident » ? Au sein même de la communauté française présente au Japon, les avis divergent sur la conduite à tenir.
Enfin, coté japonais. La situation est déjà en partie compréhensible à travers les deux paragraphes précédents. De façon globale, le Japon est encore très divisé entre le concept Jōi (« expulsion des barbares ») et celui de l’inévitable ouverture du pays aux étrangers. Le pouvoir politique est, comme nous venons de le voir, affaibli par la coexistence d’une part, d’un tout nouveau gouvernement doté d’une nouvelle mentalité et de nouveaux objectifs forcément difficiles à imposer et de plus sans expérience, et d’autre part, d’une gigantesque administration qui n’a pas encore pu évolué et qui est plutôt conservatrice. Au moment de « l’incident de Kōbe », la restitution de ses pouvoirs par le shōgun est effective depuis plusieurs mois mais l’ère Meiji ne débutera officiellement que 8 mois plus tard, en octobre 1868. Bref, tout est « en cours », il règne à tous les niveaux une grande instabilité. Et depuis quelques jours, une bataille s’est engagée, qui va évoluer en véritable guerre qui va durer près d’un an et demi. Et c’est précisément en raison de ce conflit que le nouveau gouvernement japonais a dépêché des troupes de Bizen à Kōbe et surtout à Nishinomiya où se trouvent des forces restées fidèles au shōgun afin de les surveiller.
Dans ses relations avec les étrangers, la situation du Japon est également assez compliquée. Il subsiste toujours une grande méfiance vis-à-vis de ces puissances qui se déclarent plutôt pacifistes avec lui mais qui ont, dans les faits, colonisé tout le reste de l’Asie. Comment être persuadé de leur franchise et de leur honnêteté ? D’un autre coté, le Japon doit lui aussi donner des gages de sa bonne volonté. Notamment en facilitant l’accès des commerçants étrangers à de plus en plus de régions et en leur permettant ainsi de développer leurs activités. Qui certes, les enrichissent eux, mais qui enrichissent et modernisent aussi le Japon. C’est pourquoi le gouvernement japonais, malgré ses réticences, a décidé et ordonné l’ouverture du port de Kōbe. Celle-ci est fixée et entre en vigueur le 1er janvier 1868.
De nombreux étrangers vivaient déjà dans cette ville et y travaillaient, mais l’ouverture du port est un véritable événement plein de promesses pour l’avenir. Et à l’origine, c’est essentiellement pour participer aux fêtes liées à l’inauguration de ce port que des navires américains, anglais et français ont quitté Yokohama et se sont rendus dans la rade de Kōbe. Sans savoir que cette ouverture allait rapidement être à l’origine de ce premier incident grave.
Une autre donnée est très importante pour bien comprendre cet « incident de Kōbe », qui est du registre de la culture et de la tradition. Pour les gardes japonais, ces deux marins qui ont tenté de couper leur colonne n’ont pas  fait que simplement la perturber, ils ont commis un véritable outrage qu’on appelle tomowari, un acte considéré dans la tradition des samouraïs comme non seulement belliqueux mais également comme hautement irrespectueux. D’où la réaction, « normale » de son point de vue, de TAKI Zenzaburō(photo de gauche), qui a blessé l’un de ces marins au moyen de sa lance. Coté français, on ignorait tout de cette tradition, et de façon plus générale, de nombreux historiens ou spécialistes français de cette époque reconnaissent une certaine arrogance – ou une arrogance certaine – dans le comportement d’une bonne partie de la communauté française de l’époque, dont certains membres se comportait en parfaits colons bien plus qu’en amis. Et coté japonais, les troupes de Bizen n’étaient en rien habituées aux étrangers, elle ne connaissaient ni leur mentalité ni leur langue et aucun interprète ne les accompagnait. La présence d’un seul d’entre eux et quelques explications auraient peut-être suffit à changer le cours de l’histoire…
fait que simplement la perturber, ils ont commis un véritable outrage qu’on appelle tomowari, un acte considéré dans la tradition des samouraïs comme non seulement belliqueux mais également comme hautement irrespectueux. D’où la réaction, « normale » de son point de vue, de TAKI Zenzaburō(photo de gauche), qui a blessé l’un de ces marins au moyen de sa lance. Coté français, on ignorait tout de cette tradition, et de façon plus générale, de nombreux historiens ou spécialistes français de cette époque reconnaissent une certaine arrogance – ou une arrogance certaine – dans le comportement d’une bonne partie de la communauté française de l’époque, dont certains membres se comportait en parfaits colons bien plus qu’en amis. Et coté japonais, les troupes de Bizen n’étaient en rien habituées aux étrangers, elle ne connaissaient ni leur mentalité ni leur langue et aucun interprète ne les accompagnait. La présence d’un seul d’entre eux et quelques explications auraient peut-être suffit à changer le cours de l’histoire…
C’est pour toutes ces raisons que ce qu’on appelle « l’incident de Kōbe » s’est transformé en un incident diplomatique de grande envergure. L’issue « pratique » de cet incident a déjà été évoquée : la Cour Impériale a très rapidement officialisé le nouveau gouvernement japonais auprès des puissances étrangères. Et 20 jours après l’incident, TAKI Zenzaburō a été « sacrifié » pour raison d’État : ce nouveau gouvernement accepte de le contraindre à se faire seppuku. Uniquement pour accéder aux souhaits, pourtant jugés bien trop exigeants et lourds, des Anglais et des Français. La cérémonie aura lieu le 3 mars suivant, dans la plus pure tradition japonaise. Les étrangers, satisfaits par ce geste, décident de libérer le centre-ville de Kōbe que leurs soldats occupaient encore.
Mais si cet incident est en réalité si important – une importance pas toujours assez comprise et soulignée semble-t-il – c’est en raison des sous-entendus qu’il comporte ainsi que des conséquences qui en découleront de façon directe et indirecte.
Le premier des sous-entendus est que, en acceptant de considérer comme clos cet incident avec le suicide rituel de TAKI, les puissances étrangères ont, de fait, reconnu le nouveau gouvernement japonais. Certes, la Cour Impériale l’avait officialisé. Mais il restait aux étrangers de le reconnaître, ce qui se fit donc à cette occasion de façon implicite. Et, en reconnaissant ce gouvernement, les puissances étrangères sous-entendaient aussi que, même sans prendre officiellement partie dans le conflit naissant, elles reconnaissaient implicitement le pouvoir du jeune empereur qui l’avait nommé comme étant bien la nouvelle autorité suprême.
Deuxième fait sous-entendu, c’est que les deux parties en présence reconnaissaient que cet incident était né plus en raison d’une méconnaissance culturelle réciproque que sur des intentions volontairement belliqueuses. Même si bien sûr chacun faisait des efforts pour essayer de mieux connaître l’autre, la participation du Japon à l’Exposition Universelle de 1867 en est une preuve manifeste, il s’agissait là le plus souvent de volontés individuelles, celle de Yoshinobu, celle de quelques hommes, plus qu’une volonté et qu’une politique officielle d’un État. Et c’est à cette  occasion que le nouveau gouvernement, prenant conscience qu’il lui fallait faire bien plus cas de la présence étrangère et de sa culture, nomma un homme spécifiquement chargé des relations diplomatiques. Cet homme, c’était ITŌ Hirobumi. Un jeune homme (photo de gauche) qui rentrait tout juste d’un séjour en Angleterre, durant lequel il avait lui-même complètement changé de mentalité. Originaire de Chōshū, réputé pour être le plus « anti-étrangers » des domaines, et parti dans le but d’étudier la marine britannique pour mieux pouvoir la combattre dans son pays, il avait été subjugué par sa puissance et au-delà, par le modernisme de ce pays et avait réalisé que l’avenir de sa propre patrie ne pouvait passer que par le fait d’éviter à tout prix tout combat militaire qui ne pouvait conduire qu’à sa défaite tant l’écart des forces était grand et d’autre part, par l’ouverture pacifique de son pays pour rapidement le moderniser comme l’était l’Angleterre. Et c’est à ITŌ que revint la charge de négocier avec la coalition américano-franco-britannique lors de « l’incident de Kōbe ». C’est grâce à son acharnement à convaincre les consuls PARKES et ROCHES que ceux-ci acceptèrent la solution proposée par ITŌ, le seppuku de TAKI pour laver l’affront fait aux étrangers. Et c’est toujours lui qui parvint à faire aussi accepter cette décision au chef du clan de Bizen, pourtant hostile à toute sanction envers son samouraï, surtout si lourde. ITŌ réussit ce tour de force en usant d’une raison transcendante. Au lieu de dire que c’était une décision de tel ou tel étranger, donc d’un homme, il invoqua une raison supérieure : il cita ce qu’on appelait Bankoku kōhō, un livre intitulé « les éléments du droit international » et admis comme l’ouvrage de référence par la communauté internationale de l’époque. Il parvint à faire comprendre à son interlocuteur que le Japon, s’il ne devait certes pas se soumettre totalement au droit spécifique d’une seule nation étrangère, ne pouvait plus, à l’inverse, n’observer que ses propres lois traditionnelles, et que s’il voulait être accepté par l’ensemble de la communauté internationale, il se devait d’observer les lois internationales qui régissaient les rapports entre toutes les nations. Et dans ce Bankoku Kōhō, il était une loi clairement définie : «Le principe est que, si le ressortissant d’un pays (à comprendre dans le sens d’un « domaine » japonais) commet un acte criminel contre un ressortissant étranger, il revient au chef de clan de ce pays d’en assumer l’entière responsabilité».
occasion que le nouveau gouvernement, prenant conscience qu’il lui fallait faire bien plus cas de la présence étrangère et de sa culture, nomma un homme spécifiquement chargé des relations diplomatiques. Cet homme, c’était ITŌ Hirobumi. Un jeune homme (photo de gauche) qui rentrait tout juste d’un séjour en Angleterre, durant lequel il avait lui-même complètement changé de mentalité. Originaire de Chōshū, réputé pour être le plus « anti-étrangers » des domaines, et parti dans le but d’étudier la marine britannique pour mieux pouvoir la combattre dans son pays, il avait été subjugué par sa puissance et au-delà, par le modernisme de ce pays et avait réalisé que l’avenir de sa propre patrie ne pouvait passer que par le fait d’éviter à tout prix tout combat militaire qui ne pouvait conduire qu’à sa défaite tant l’écart des forces était grand et d’autre part, par l’ouverture pacifique de son pays pour rapidement le moderniser comme l’était l’Angleterre. Et c’est à ITŌ que revint la charge de négocier avec la coalition américano-franco-britannique lors de « l’incident de Kōbe ». C’est grâce à son acharnement à convaincre les consuls PARKES et ROCHES que ceux-ci acceptèrent la solution proposée par ITŌ, le seppuku de TAKI pour laver l’affront fait aux étrangers. Et c’est toujours lui qui parvint à faire aussi accepter cette décision au chef du clan de Bizen, pourtant hostile à toute sanction envers son samouraï, surtout si lourde. ITŌ réussit ce tour de force en usant d’une raison transcendante. Au lieu de dire que c’était une décision de tel ou tel étranger, donc d’un homme, il invoqua une raison supérieure : il cita ce qu’on appelait Bankoku kōhō, un livre intitulé « les éléments du droit international » et admis comme l’ouvrage de référence par la communauté internationale de l’époque. Il parvint à faire comprendre à son interlocuteur que le Japon, s’il ne devait certes pas se soumettre totalement au droit spécifique d’une seule nation étrangère, ne pouvait plus, à l’inverse, n’observer que ses propres lois traditionnelles, et que s’il voulait être accepté par l’ensemble de la communauté internationale, il se devait d’observer les lois internationales qui régissaient les rapports entre toutes les nations. Et dans ce Bankoku Kōhō, il était une loi clairement définie : «Le principe est que, si le ressortissant d’un pays (à comprendre dans le sens d’un « domaine » japonais) commet un acte criminel contre un ressortissant étranger, il revient au chef de clan de ce pays d’en assumer l’entière responsabilité».  Et en l’occurrence, ce chef du domaine de Bizen ne put que s’incliner et assumer la sienne. ITŌ fit néanmoins preuve d’une grande aptitude à la diplomatie, comprenant que celle-ci ne peut aboutir que si les deux parties en présence en ressortent, sinon gagnantes, au moins avec les honneurs. Et c’est ainsi qu’il réussit aussi à convaincre la coalition étrangère de déléguer des observateurs lors de la « cérémonie » du seppuku de TAKI (photo de droite, cette scène du seppuku). Il voulait que ces étrangers, qui n’avaient jamais assisté à ce genre de rituel, comprennent l’importance des traditions et le courage des samouraïs japonais. On dit même qu’à ces observateurs, très choqués par cette scène, il « enfonça le clou » de façon très diplomatique en ne disant qu’un mot « nous en avons tous été témoins, n’est-ce pas ? ».
Et en l’occurrence, ce chef du domaine de Bizen ne put que s’incliner et assumer la sienne. ITŌ fit néanmoins preuve d’une grande aptitude à la diplomatie, comprenant que celle-ci ne peut aboutir que si les deux parties en présence en ressortent, sinon gagnantes, au moins avec les honneurs. Et c’est ainsi qu’il réussit aussi à convaincre la coalition étrangère de déléguer des observateurs lors de la « cérémonie » du seppuku de TAKI (photo de droite, cette scène du seppuku). Il voulait que ces étrangers, qui n’avaient jamais assisté à ce genre de rituel, comprennent l’importance des traditions et le courage des samouraïs japonais. On dit même qu’à ces observateurs, très choqués par cette scène, il « enfonça le clou » de façon très diplomatique en ne disant qu’un mot « nous en avons tous été témoins, n’est-ce pas ? ».
 Il est à noter que plus tard, ITŌ Hirobumi continuera sa carrière politique et réussira l’un des parcours les plus extraordinaires de l’histoire du Japon. Lui qui, à l’origine, était né dans une famille de paysans normalement sans grand avenir, il deviendra samouraï, puis politicien, gravira très rapidement les échelons et sera finalement nommé le tout premier 1er Ministre du Japon. Et non seulement il deviendra ainsi le plus jeune de tous les Premiers ministres jusqu’à nos jours mais de plus, il occupera cette fonction à 4 reprises, record national absolu (photo de gauche).
Il est à noter que plus tard, ITŌ Hirobumi continuera sa carrière politique et réussira l’un des parcours les plus extraordinaires de l’histoire du Japon. Lui qui, à l’origine, était né dans une famille de paysans normalement sans grand avenir, il deviendra samouraï, puis politicien, gravira très rapidement les échelons et sera finalement nommé le tout premier 1er Ministre du Japon. Et non seulement il deviendra ainsi le plus jeune de tous les Premiers ministres jusqu’à nos jours mais de plus, il occupera cette fonction à 4 reprises, record national absolu (photo de gauche).
C’est ainsi qu’au lieu de n’être qu’un « simple » incident de parcours, celui de Kōbe marque la « grande » histoire du Japon en le faisant entrer véritablement dans la communauté internationale et ce, pour la première fois, au moyen de la diplomatie. Il est aussi l’un des éléments fondateurs d’un changement radical de la politique japonaise, qui passera d’un jōi (« expulsion des barbares étrangers ») quasi généralisé à un kaikoku washin que l’on peut traduire par « l’ouverture du pays de façon pacifique et amicale». Il s’agissait à l’origine d’une expression conçue par la Cour Impériale, impressionnée par le succès diplomatique de ITŌ, à l’intention de l’ensemble de son nouveau gouvernement dans lequel subsistaient encore quelques personnages à la pensée dorénavant jugée comme « archaïque ». Cette pensée ou directive s’étendit progressivement à toute l’administration et auprès des familles dirigeant les domaines provinciaux puis enfin à toute la population japonaise. Certes, la résistance demeurera, notamment avec la Guerre de Boshin qui en est l’une des dernières survivances. Mais, en quelques années et près quelques autres épisodes plus ou moins tragiques, ce concept finit par s’imposer dans tout le pays.
En ce sens, on peut donc peut-être dire, comme le titre de cet article le suggère, que « l’incident de Kōbe », à l’origine de ce kaikoku washin qui met en exergue la volonté de paix et d’amitié, constitue le véritable acte fondateur, sinon de sa totalité puisque le commerce avait déjà bien débuté, mais au moins pour des deux-tiers – les deux premiers thèmes cités – du traité signé dix ans plus tôt avec notre pays, en 1858, et qui, pour rappel, a pour nom le « Traité de paix, d’amitié et de commerce entre la France et le Japon ». Et qu’il est l’acte de naissance de 150 ans de relations franco-japonaises faites surtout, quelques petits épisodes de refroidissements passagers mis à part, de paix, d’amitié, et même au-delà, de reconnaissance, de respect et d’admiration réciproques.
Depuis 1961, la ville de Kōbe est jumelée à la ville de Marseille, toutes deux ports de commerce majeur de leur pays respectif.
****************
A noter que, dans le cadre des commémorations des 150 ans de la Restauration de Meiji en 2018, le port de Kōbe a décidé de débuter avant tout le monde et de commémorer l’ouverture de son port, le 1er janvier 1868, tout au long de l’année… 2017 !
Cette commémoration des « 150 ans du port de Kōbe » a en effet été lancée, depuis le 1er janvier de cette année, en profitant d’un point de vue original. Au lieu d’attendre le jour de l’anniversaire plein, c’est-à-dire le 1er janvier 2018 et de commémorer « les 150 ans », le port fêtera plutôt « la 150ème année ». Laquelle se trouve en effet être l’année 2017.
Différents événements ponctueront donc cette année 2017, dont le « main festival » ou festival principal est prévu pour le week-end du 20 et du 21 mai 2017 comme l’indique cette affiche ci-dessous.

(C.Y.)