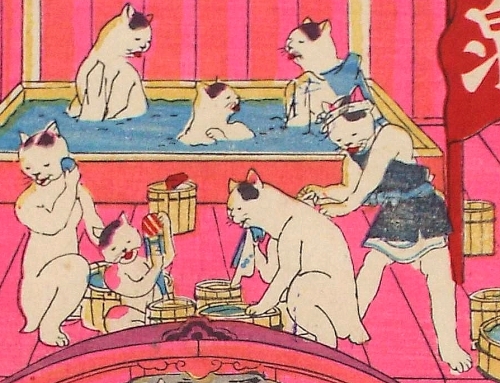L’ère Meiji est généralement présentée comme la période de transition entre un Japon ancien, féodal, fermé (voir La « querelle » du sakoku) et le Japon moderne, occidentalisé et ouvert sur le monde. Une transition souvent qualifiée d’étonnante parce qu’elle se serait faite très rapidement et pratiquement sans conflit, presque dans la douceur. On évoque pour expliquer cela le fait que les Japonais, peuple particulièrement animé par le sens du collectif, auraient suivi sans contester le destin moderne que leur proposait leur nouvel empereur qui avait recouvré l’ensemble des pouvoirs militaires et politiques lesquels, jusque là, étaient détenus par le shōgun.
La réalité n’est pas si prosaïque, la vérité est bien plus complexe. Si quelques grands bouleversements se sont effectivement opérés de façon pacifique, le seul point vraiment exact de cette courte présentation est sans doute l’adverbe «rapidement». Car si l’on observe les faits tels qu’ils se sont succédé et si l’on compare le Japon du début des années 1850 et ce qu’il est devenu 30 ans plus tard, alors oui, ce pays s’est transformé de façon très rapide. Et si on parle officiellement de la « Restauration de Meiji » pour définir cette période de l’histoire japonaise durant laquelle on assista au renversement du shogunat et à la restitution par le shōgun de tous ses pouvoirs et tous les territoires qu’il administrait directement à l’empereur, c’est parce que le fait considéré comme le plus notoire est bien le moment précis où cette souveraineté totale de l’empereur fut restaurée après 7 siècles. Mais on pourrait aussi sans doute parler de «révolution de Meiji» tant les bouleversements ont été nombreux et importants durant cette période, voire même de «miracle de Meiji» comme l’a pensé le romancier SHIBA Ryōtarō tant ils ont été surprenants et même impensables. Le monde entier s’en étonne encore aujourd’hui.
Mais pour bien comprendre comment la Restauration de Meiji a pu survenir en 1868, il convient tout d’abord de remonter un peu dans le temps et de prendre en compte le contexte national et international dans lequel le Japon se trouvait dans le début des années 1850.
Le contexte national.
Quelques mots tout d’abord sur l’organisation politique du pays.
Depuis la nuit des temps, selon la légende, le Japon est un empire dont le chef, l’empereur, appartient à une seule et même dynastie et dont le fondateur descend de la déesse du soleil, Amaterasu. Il est donc plus qu’un homme, il est un symbole et jamais le Japon n’aura l’idée d’abolir cette institution quasi divine.
Par contre, comme tous les pays du monde, le Japon est un pays qui a évolué au fil des siècles, et depuis environ 700 ans, le pouvoir militaire et politique est détenu par celui qu’on appelle le shōgun, abréviation de seiitai shōgun. En effet, au 12ème siècle, la caste des guerriers est suffisamment importante pour qu’elle devienne, quasiment de facto, celle qui domine militairement toutes les autres castes (religieux, paysannerie, commerçants…) et même la famille impériale. Les plus puissants de ces guerriers, disséminés à travers le pays, se sont réunis dans la ville de Kamakura et ont fondé le Kamakura bakufu, c’est-à-dire le «gouvernement de Kamakura», que l’empereur, installé depuis plusieurs siècles déjà dans la ville de Kyōto mais militairement plus faible, est contraint de reconnaître (1192). Le pays sera ainsi dirigé par deux institutions : le chōtei, la Cour Impériale avec l’empereur a sa tête, et le bakufu, le gouvernement dont le chef est un «chef de guerre», le shōgun. Si le shōgun est, de fait, le plus fort et le plus puissant de tous les guerriers (bushō) et de toutes les familles, son autorité est malgré tout officiellement soumise à la bénédiction de l’empereur qui peut, en théorie, le nommer ou le congédier. Dans les faits, les différents shōgun qui se sont succédé auront surtout accédé à ce titre suprême par deux moyens : la succession ou la conquête par la force.
A cette époque, le Japon est grossièrement divisé en un peu moins de 10 grandes provinces dont la direction est confiée par le shōgun à un seigneur appelé daimyō. Puis au milieu du 16ème siècle, selon une idée qu’on attribue à ODA Nobunaga (photo de gauche) mais qui fut réalisée par son successeur TOYOTOMI Hideyoshi, un nouveau découpage administratif plus complexe est mis en place. Les grandes régions sont divisées en domaines (han) qui  seront dirigés par un daimyō (titre équivalent à «seigneur») qu’on appelle également hanshu c’est-à-dire « chef de domaine ».
seront dirigés par un daimyō (titre équivalent à «seigneur») qu’on appelle également hanshu c’est-à-dire « chef de domaine ».
A l’intérieur de son domaine ou han, s’il est un suzerain local ayant quasiment tous les droits sur ses sujets, le hanshu est en revanche souvent menacé par d’autres grandes familles et il doit les soumettre. Et à l’extérieur, il est également menacé par les autres domaines et doit aussi les dominer d’une façon ou d’une autre.
La taille des han est variable. L’originale unité de mesure est ce qu’on appelle un koku, qui correspond à la quantité de riz consommé en moyenne par un homme pendant une année. C’est donc aussi une surface, celle qui est nécessaire pour produire cette quantité de riz. La taille minimale des han est de 10.000 koku, les plus grands atteindront le million de koku. Et donc, le nombre de koku dont un domaine peut se réclamer témoigne de sa grandeur et de sa puissance puisque cela suggère sa superficie, sa population, sa puissance économique. Un hanshu percevant les impôts, plus son domaine sera grand et prospère, plus lui-même sera riche et puissant. A l’époque d’Edo, on comptera jusqu’à environ 300 han.
Et c’est donc le plus puissant, le plus influent et le plus habile de ces seigneurs qui réussira à devenir le chef de tous et qui sera le shōgun. Ainsi, le territoire des TOKUGAWA, dont la dynastie fournira les shōgun de l’ère d’Edo, atteindra les 4 millions de koku.
Le shōgun se doit d’asseoir son autorité nationale, laquelle peut être contestée par beaucoup de rivaux et de prétendants au titre suprême : des membres ambitieux de sa propre famille, frères, cousins, etc, des familles rivales de son propre domaine d’origine ou encore des grands «clans» de domaines rivaux. Bref, la situation est enviable mais non de tout repos. La guerre est presque permanente, même si l’autre moyen de se maintenir à ce poste est bien sûr le système des alliances. Un moyen pacifique mais qui comporte aussi un grand risque : la trahison et le renversement de ces alliances.
C’est ainsi que le Japon sera presque continuellement agité par des batailles «locales» en vue de la conquête de nouveaux territoires, voire du pouvoir suprême. Quelques époques seront relativement calmes, d’autres seront particulièrement agitées. Parmi celles-ci, on retiendra notamment la période de ce qu’on appelle en japonais Jishō-Juei no ran ou la «bataille de Jishō-Juei» de façon officielle et plus communément la «bataille de Genpei». Ce nom de Genpei est constitué des deux kanjis qui composent les noms des deux familles qui s’affrontent : les MINAMOTO (un kanji qui se lit aussi gen) et les TAIRA (un kanji qui se lit aussi hei ou pei). Une guerre de 1180 à 1185 qui s’achèvera, à ma bataille de Dan no ura sur la victoire de MINAMOTO no Yoritomo qui devint ainsi le tout premier seiitai shōgun et fondera le gouvernement de Kamakura ou Kamakura bakufu.
 L’autre période la plus célèbre est celle qu’on appelle Sengoku jidai ou « époque du pays en guerre » qui couvrira en gros tout le 16ème siècle et verra, dans la seconde moitié de ce siècle, se succéder trois des plus grands chefs de clans dont le dernier seulement deviendra un seiitai shōgun: ODA Nobunaga, TOYOTOMI Hideyoshi (photo de gauche) et TOKUGAWA Ieyasu (photo de droite) que l’on appelle souvent uniquement par leur prénom tellement ils sont connus et que l’on présente comme les trois principaux «unificateurs» du Japon. Dernier des trois
L’autre période la plus célèbre est celle qu’on appelle Sengoku jidai ou « époque du pays en guerre » qui couvrira en gros tout le 16ème siècle et verra, dans la seconde moitié de ce siècle, se succéder trois des plus grands chefs de clans dont le dernier seulement deviendra un seiitai shōgun: ODA Nobunaga, TOYOTOMI Hideyoshi (photo de gauche) et TOKUGAWA Ieyasu (photo de droite) que l’on appelle souvent uniquement par leur prénom tellement ils sont connus et que l’on présente comme les trois principaux «unificateurs» du Japon. Dernier des trois  et, dans les faits, héritier de l’action des deux précédents, Ieyasu s’imposera, l’empereur le reconnaitra comme seiitai shōgun et il constituera le gouvernement d’Edo (Edo bakufu) qui voit le jour en 1602 et s’achèvera en 1868 et le début de l’ère Meiji. Edo, le nom d’un petit village d’une grande plaine appelée Kantō qui devient donc la capitale shogunale – tandis que la «vraie» capitale, celle où résident l’empereur et sa cour, est Kyōto – et qui, plus tard, prendra le nom de Tōkyō. Une longue période de plus de 260 années durant laquelle le Japon connaitra une paix assez généralisée, favorable à un essor commercial, artisanal, culturel et artistique. Mais qui dit paix dit aussi absence de guerre, et donc affaiblissement inévitable des militaires…
et, dans les faits, héritier de l’action des deux précédents, Ieyasu s’imposera, l’empereur le reconnaitra comme seiitai shōgun et il constituera le gouvernement d’Edo (Edo bakufu) qui voit le jour en 1602 et s’achèvera en 1868 et le début de l’ère Meiji. Edo, le nom d’un petit village d’une grande plaine appelée Kantō qui devient donc la capitale shogunale – tandis que la «vraie» capitale, celle où résident l’empereur et sa cour, est Kyōto – et qui, plus tard, prendra le nom de Tōkyō. Une longue période de plus de 260 années durant laquelle le Japon connaitra une paix assez généralisée, favorable à un essor commercial, artisanal, culturel et artistique. Mais qui dit paix dit aussi absence de guerre, et donc affaiblissement inévitable des militaires…
Le contexte international.
Dans les années 1850, la situation internationale est particulière. En Asie, quelques puissances européennes, en pleine expansion colonialiste, se sont emparées de plusieurs territoires : parmi les principales, on peut citer l’Empire Britannique qui est présent en Chine, la France en Indochine et la Hollande en Indonésie. Si le but de ces colonies est essentiellement commercial, elles ne se font pas sans guerres, massacres ou mise en partiel ou total esclavage des populations. Économiquement, les colons détruisent les économies de ces pays en leur vendant très cher leur propre production et en acquérant à un prix très faible les denrées locales. En résumé, les colonies qui prétextent une modernisation des pays concernés font souvent plus de mal que de bien.
De son coté, le Japon a été épargné en raison d’une politique isolationniste mise en place en 1639 par le troisième shōgun de la dynastie des TOKUGAWA (qui en comptera 15), Iemitsu. Celui-ci a conclu toute une période de crainte et même de « chasse » aux étrangers (dont beaucoup de missionnaires) en décrétant le sakoku, c’est-à-dire la fermeture totale du pays et son isolement par rapport au reste du monde. Seuls les Hollandais et les Chinois auront le droit d’entretenir des relations avec le bakufu ou ceux que celui-ci a autorisé, des relations diplomatiques et surtout commerciales – mais qui serviront aussi au gouvernement à se tenir relativement bien informé des progrès occidentaux en matière politique, religieuse, militaire etc. Tous les autres pays qui auront essayé de nouer de telles relations avec le Japon auront été éconduits, et leurs éventuelles tentatives militaires auront échoué. Plus de 200 ans plus tard, la politique isolationniste du bakufu est toujours en vigueur. Mises à part quelques rares exceptions, le peuple, lui, ignore pratiquement tout de «l’étranger» et notamment de l’Occident.
C’est alors que deux autres pays vont surgir et que leur action va constituer le détonateur de toute la transformation future du Japon : la Russie pour partie, et surtout les États-Unis d’Amérique.
31 mars 1854 : le jour où tout a basculé.
Nous sommes en 1853. La « jeune » Amérique en plein essor n’a pas encore de relations avec l’Asie comme en ont les grandes puissances européennes. Or elle vient de remporter en 1848 une victoire contre le Mexique qui lui a, entre autres, permis d’annexer la Californie. Et là, elle a remarqué que, là où il fallait, pour elle comme pour les Européens, environ 5 mois de navigation pour se rendre en Asie en passant par l’Atlantique, le sud de l’Afrique et l’Océan Indien, il ne lui faudrait sans doute guère plus qu’une vingtaine de jours en traversant le Pacifique. Une nouvelle perspective s’ouvre donc à elle, qui lui confèrerait de surcroît un énorme avantage sur les nations européennes. Mais à une condition : pour accéder en tous lieux de la vaste Asie, il lui faudra pouvoir ravitailler en chemin, notamment en charbon pour faire avancer ses navires à vapeurs. Ce lieu de ravitaillement, ce sera donc le Japon, certes « fermé » pour l’heure, mais donc, inversement, encore libre et indépendant.
Ce sera aussi le Japon pour une autre raison. Le commodore Matthew Calbraith PERRY (photo de gauche), un marin qui s’est particulièrement illustré lors de la guerre contre le Mexique, a  appris qu’en 1848, le navire américain le « Lagoda » s’est échoué au large du Japon et que 15 de ses survivants sont retenus au Japon. Mais que, dans ce pays, les naufragés sont traités comme des criminels. Ils sont emprisonnés et, de plus, on les oblige à fouler de leurs pieds des images religieuses pour les forcer à renier leur croyance. C’est un scandale grandissant dont la presse américaine se fait largement l’écho. PERRY décide alors d’écrire à son gouvernement en disant, en substance, qu’il était de l’honneur des États-Unis d’instaurer des relations avec le Japon pour, au-delà de l’aspect purement commercial, y faire respecter les règles du Droit international ainsi que les Droits de l’Homme ignorés par cette nation barbare. Pour, par exemple, éviter qu’à l’avenir, d’autres naufragés connaissent le même sort. C’est le 29 mai 1851 que la mission souhaitée par le commodore PERRY lui est finalement confiée.
appris qu’en 1848, le navire américain le « Lagoda » s’est échoué au large du Japon et que 15 de ses survivants sont retenus au Japon. Mais que, dans ce pays, les naufragés sont traités comme des criminels. Ils sont emprisonnés et, de plus, on les oblige à fouler de leurs pieds des images religieuses pour les forcer à renier leur croyance. C’est un scandale grandissant dont la presse américaine se fait largement l’écho. PERRY décide alors d’écrire à son gouvernement en disant, en substance, qu’il était de l’honneur des États-Unis d’instaurer des relations avec le Japon pour, au-delà de l’aspect purement commercial, y faire respecter les règles du Droit international ainsi que les Droits de l’Homme ignorés par cette nation barbare. Pour, par exemple, éviter qu’à l’avenir, d’autres naufragés connaissent le même sort. C’est le 29 mai 1851 que la mission souhaitée par le commodore PERRY lui est finalement confiée.
PERRY détient un autre atout : ses filles fréquentent des jeunes gens issus du milieu industriel, lui-même a noué de fort liens avec les grands industriels de son pays et il a une très bonne connaissance de ce secteur ainsi que de celui du commerce international. Fin stratège, il se plonge alors dans l’apprentissage du Japon et de la mentalité des Japonais. Il en conclut plusieurs choses : pour être crédible, il lui faut à tout prix se montrer fort et inflexible face aux Japonais si ceux-ci tentent de biaiser. D’autre part, il sait que les décideurs japonais confient souvent les négociations à des intermédiaires sans pouvoir de décision, ce qui a pour effet d’allonger la durée des entretiens et de leur donner le temps de la réflexion et de préparer d’éventuelles ripostes. Par contre, il a compris qu’il ne fallait pas non plus exiger des Japonais une réponse immédiate. Investi par son gouvernement, PERRY prépare soigneusement sa future mission.
Un événement va précipiter le départ de PERRY vers le Japon. La Russie, autre grande puissance qui lorgne aussi sur le Japon, fait partir vers ce pays un navire commandé par le lieutenant-général Ievfimy POUTIATINE, lui aussi chargé d’une mission diplomatique pour tenter «d’ouvrir» le Japon. Alors que le navire russe quitte son pays et commence son périple vers l’Asie, PERRY n’est pas encore prêt. Il ne pourra lui-même lever l’ancre qu’un mois et demi après le Russe. Mais la chance est avec lui. A peine parti, le bateau de POUTIATINE est victime d’une avarie technique qui le cloue au Danemark, ce qui permet à l’Américain de combler son retard et même de prendre l’avantage.
En juillet 1853, «l’USS Mississippi» (photo de gauche) qu’il commande et trois autres navires pénètrent dans le port d’Uraga, à l’entrée de la baie d’Edo,  donc tout près de la capitale shogunale. Très précisément, le 8 juillet. On sait aujourd’hui que, s’il n’en connaissait pas la date précise, le bakufu avait été prévenu de cette arrivée dès 1852, alerté par une note fournie par les Hollandais avec lesquels il entretenait des rapports commerciaux privilégiés à Nagasaki. Mais à l’époque, il semble qu’il n’avait pas pris la mesure de l’événement et n’avait pris aucune décision pour s’y préparer – notamment en tentant de renforcer son armée.
donc tout près de la capitale shogunale. Très précisément, le 8 juillet. On sait aujourd’hui que, s’il n’en connaissait pas la date précise, le bakufu avait été prévenu de cette arrivée dès 1852, alerté par une note fournie par les Hollandais avec lesquels il entretenait des rapports commerciaux privilégiés à Nagasaki. Mais à l’époque, il semble qu’il n’avait pas pris la mesure de l’événement et n’avait pris aucune décision pour s’y préparer – notamment en tentant de renforcer son armée.
Sur un frêle esquif, quelques fonctionnaires japonais s’approchent des navires américains et tentent des pourparlers. PERRY ne se montre pas et leur fait répondre que le commandement américain ne s’adressera qu’aux plus hautes autorités gouvernementales japonaises. Il met ainsi en œuvre le plan qu’il a conçut en étudiant le comportement des Japonais. Lorsque les émissaires du gouvernement sont enfin autorisés à monter à bord, PERRY leur fait savoir, par l’intermédiaire de ses officiers et sans toujours se montrer, qu’il exige de remettre une lettre de son Président écrite à l’attention des plus hautes autorités japonaises. Les fonctionnaires japonais lui rétorquent alors que la réglementation de leur pays l’obligent à envisager toute négociation à Nagasaki, seul port habilité à traiter avec les étrangers – et accessoirement situé dans l’île de Kyūshū, très loin du siège shogunal. PERRY voit le manège et refuse en menaçant d’employer la force et de bombarder les côtes japonaises. En substance, il répond: « Nous sommes porteurs d’une lettre de notre Président à remettre au souverain du Japon, cela ne peut se faire à Nagasaki et doit se faire dans la baie d’Edo. Si cela n’est pas accepté, nous débarquerons nos soldats et nous rendront directement au château d’Edo pour remettre cette lettre ». Et il fixe une date limite pour la réponse : dans les 3 jours.
Cette menace est en réalité un énorme coup de bluff, le Président américain lui ayant interdit tout usage de son armement et de la force. Mais les Japonais qui ignorent ce détail prennent cet avertissement très au sérieux, eux qui ont été déjà plongés dans un grand effroi en découvrant des navires d’une taille monstrueuse et inconnue par eux jusque là (le plus grand des 4 navires fait 88m de long!), qui peuvent naviguer sans voile grâce à un système de propulsion qui projette une grosse fumée sombre et qui sont enfin d’un aspect effrayant, ils sont très puissamment armés et toute la coque étant enduite d’une sorte de goudron pour protéger le bois : ce sont les fameux «bateaux noirs» ou Kurobune. Au château d’Edo, donc du shōgun, on s’inquiète et les avis divergent. Certains jugent ne pas devoir accepter cette lettre et proposent de forcer les navires à repartir. D’autres pensent plus prudent d’accepter cette lettre mais sans rien promettre de plus. La veille de la date limite, PERRY fait alors avancer un de ses bateaux plus en avant dans la baie, lequel devient menaçant pour la population côtière. La peur qui s’empare alors de la population d’Edo finit par convaincre les plus hautes autorités du bakufu de devoir éviter l’affrontement et d’accepter la lettre du Président des États-Unis.
De façon plus anecdotique, on sait aujourd’hui que cette inquiétude de la population ne fut pas partagée par tous et que beaucoup d’intrépides se transformèrent en parfaits touristes et se rendirent d’Edo à Uraga avec l’espoir d’apercevoir ces fameux «bateaux noirs». D’aucuns prétendent même que ce fut, pendant quelques jours, un véritable « boom » touristique qui s’empara des habitants d’Edo.
C’est finalement le 14 juillet 1853 que PERRY et 300 soldats débarquent à 10h du matin sur le sol japonais sur les plages de Kurihama. Le Commodore se montre pour la première fois. Et la lettre de demande d’ouverture du Japon émanant du président américain est remise à un très haut représentant du bakufu. Or cette lettre contenait une phrase particulière qui disait en substance: « Nous demandons à l’Empereur d’autoriser des échanges commerciaux pour une période d’essai de 5 à 10 ans. Si les bénéfices coté japonais ne sont pas la hauteur de vos espérances, alors l’interdiction d’échanges telle qu’elle existe actuellement pourra être réactivée ». C’était, de la part des USA, une façon d’éviter le « non » pur et simple que les Japonais ont, jusque là, toujours réussi à opposer aux occidentaux et de leur mettre une forte pression. Pour la jeune Amérique, le but était d’être les premiers, avant les Russes et les Européens, même s’ils ne demandaient que d’entrouvrir un peu la porte du commerce : elle était en effet persuadée qu’en découvrant les marchandises américaines, les Japonais seraient forcément séduits et ne pourraient plus revenir en arrière. PERRY remet cette lettre qui n’est pas formellement un ordre mais laisse le Japon libre de son choix, ne demande pas de réponse immédiate selon ses plans et assure simplement les Japonais qu’il reviendra l’année suivante, et en fin diplomate, il fixe lui-même les délais : il reviendra recevoir la réponse au printemps prochain. «Avec cette fois une flotte bien plus importante» précise-t-il. Et il lève l’ancre…
Un autre événement va lui rendre, un peu à son insu, un grand service. Le Russe POUTIATINE arrive lui aussi au Japon juste après PERRY, en août 1853. Mais en bon diplomate, pensant que la meilleure façon d’agir avec les Japonais était de ne pas les offenser ou les menacer et d’observer leurs lois, il décide de se rendre directement à Nagasaki. Il remet lui aussi sa lettre de demande d’ouverture aux autorités locales qui promettent de l’étudier avec attention. POUTIATINE n’ignorant rien de la «mission Perry» s’en inquiète auprès des Japonais, qui promettent alors au Russe que, si d’aventure, leur gouvernement décidait d’accorder des privilèges particuliers aux États-Unis, la Russie bénéficierait alors d’avantages parfaitement similaires. POUTIATINE est rassuré, il décide alors d’attendre la réponse des Japonais. Mais il commet alors une grave erreur : il accepte le délai de réflexion que les Japonais lui demandent en l’assurant de la normalité de la durée de la procédure – mais en réalité, ils veulent juste gagner du temps : de 3 à 5 ans pour obtenir une réponse…
Quant à Matthew PERRY, toujours aussi fin stratège, c’est dès fin février 1854 qu’il retourne au Japon en provenance de Macao où il a passé l’automne et le début de l’hiver. Les Japonais, qui n’ont pas eu le temps nécessaire pour fortifier le port d’Uraga et installer une défense sur les côtes avoisinantes comme ils l’espéraient, sont pris de court. Les premières négociations commencent dans la difficulté. Il convient d’abord d’en définir le lieu. Aux Japonais qui proposent de rester dans la baie, PERRY souhaite que cela se fasse le plus près possible d‘Edo. Il pense que si les « vraies » négociations se déroulent dans un lieu aussi ou plus éloigné du siège du bakufu que la première fois, cela sera interprété comme une faiblesse de sa part. Et s’il fait preuve de faiblesse, il pense que même en cas d’accord, les Japonais feront tout pour ne pas le respecter ou tout au moins pour en gêner l’exécution. La ville de Yokohama est finalement choisie. PERRY s’y rend le 8 mars 1854, avec cette fois 500 hommes.
Commencent alors d’ultimes négociations où les Japonais sont déjà convaincus qu’ils ne pourront refuser en bloc la demande américaine. D’autre part, juste à ce moment, ils apprennent qu’une imposante et inquiétante flotte composée de navires anglais, français et hollandais a quitté les côtes du continent asiatique et se dirige vers le Japon. La raison n’est surement pas purement amicale… Les Japonais pensent alors qu’il vaut peut-être mieux accepter un moindre mal plutôt que de risquer le pire : ils acceptent d’ouvrir deux ports aux Américains uniquement pour ravitailler en eau, en vivres et en charbon, mais le commerce libre leur sera interdit. Les Japonais ont en effet observé comment les Anglais avaient opéré en Chine et combien l’autorisation d’y commercer avait en réalité affaibli l’économie de ce pays et l’avait, de facto, transformé en une colonie asservie même si cet état n’était pas officiellement reconnu. De son coté, PERRY sait que son objectif réel est le commerce. Mais il comprend que les Japonais ne cèderont pas sur ce point, il sait que malgré son coup de bluff, il ne peut pas engager les hostilités sans s’attirer les foudres de son gouvernement et il craint à son tour de tout perdre, dont son avance sur les Européens qui approchent, s’il s’acharne. Il tente un ultime argument: il affirme que les Américains sont un peuple soucieux de la vie humaine (qu’ils ne veulent pas la guerre) et que, d’autre part, le commerce bénéficiera aussi beaucoup au Japon. Il rappelle que la demande comporte une période d’essai. Profitant des mots de PERRY, l’émissaire japonais lui rétorque alors que le commerce est affaire économique et n’a aucun rapport avec la vie humaine dont il vient de parler. Le commodore comprend qu’il ne pourra aller plus loin. Avec la possibilité d’un ravitaillement en vivres et en combustible ainsi que la garantie des biens et des hommes, il vient d’obtenir la possibilité d’ouvrir la « route Pacifique ». S’il s’entête face à ces Japonais fiers et têtus, il risque de tout perdre. Il juge plus sage et plus habile de reporter cet aspect commercial du traité à plus tard et de déjà signer un document permettant aux Américains de rejoindre l’Asie en moins d’un mois grâce à cette possibilité de ravitaillement.
Et c’est ainsi que le 31 mars 1854 est signée la « Convention de Kanagawa ». Aujourd’hui, on trouve dans la ville de Yokohama un site commémorant cette signature avec notamment cette  plaque que vous voyez en photo.
plaque que vous voyez en photo.
Ce traité a été signé sans qu’une seule balle ne soit tirée. Pour l’heure, seuls les ports de Shimoda et de Hakodate sont concernés. Mais l’avantage est aux Américains puisque la convention ne comporte pas vraiment de contre-partie et devient de ce fait le premier des traités dits « inégaux » qui seront par la suite signés par le gouvernement japonais avec les Américains et les Européens. Et pour les États-Unis, si ce n’est qu’une demi-victoire car privés du volet commercial, c’est en revanche, diplomatiquement et politiquement, une fierté, voire une gloire, d’être ainsi les premiers étrangers à avoir ouvert de nouvelles relations avec le Japon. Pour celui-ci et pour son shōgun, c’est aussi en partie une satisfaction, celle d’avoir échappé à une guerre et une défaite certaine. Mais cette signature a en réalité un aspect bien plus important : elle signifie la fin du sakoku et d’une politique qui a duré 215 ans. C’est le point de départ d’une véritable «révolution» dont les Japonais d’alors n’ont en fait aucune idée de l’importance ni des conséquences qui en découleront.
Nous sommes à pratiquement 14 ans de la naissance de l’ère Meiji…
.
(C.Y.)